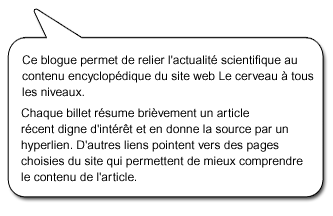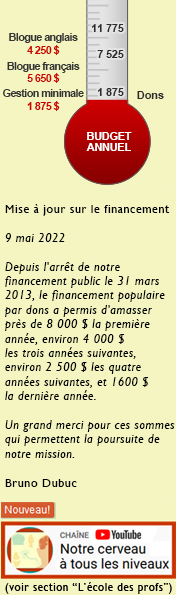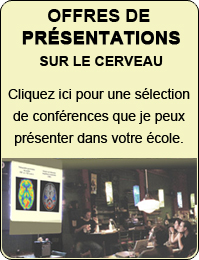lundi, 1 juin 2020
Gérer la COVID-19… à tous les niveaux !
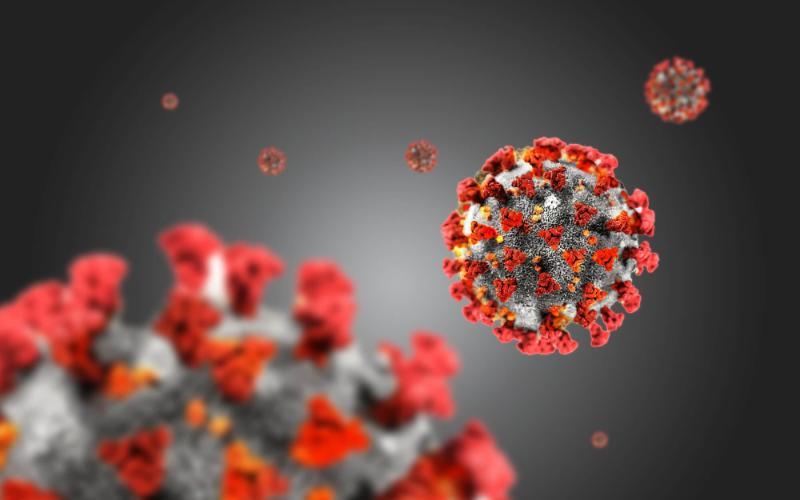 En attendant la dernière séance de la série Notre cerveau à tous les niveaux qui aura lieu mercredi le 17 juin prochain, je voudrais cette semaine faire un petit retour sur le thème de la COVID-19 avant de plonger la semaine prochaine dans le vif du sujet de cette séance intitulée « «Moi» conscient versus motivations inconscientes: notre espèce a-t-elle de l’avenir? ». Trois documents, donc, axés sur ce qu’on peut faire pour gérer le stress associé à la présence du virus, comment réduire les risques de l’attraper, et qu’est-ce qu’on peut prendre pour le combattre.
En attendant la dernière séance de la série Notre cerveau à tous les niveaux qui aura lieu mercredi le 17 juin prochain, je voudrais cette semaine faire un petit retour sur le thème de la COVID-19 avant de plonger la semaine prochaine dans le vif du sujet de cette séance intitulée « «Moi» conscient versus motivations inconscientes: notre espèce a-t-elle de l’avenir? ». Trois documents, donc, axés sur ce qu’on peut faire pour gérer le stress associé à la présence du virus, comment réduire les risques de l’attraper, et qu’est-ce qu’on peut prendre pour le combattre.
Plus un ajout de dernière minute, un peu plus pour les geeks (Karl Friston et la COVID-19 !)
* * *
Le Cœur des sciences de l’UQAM a organisé mardi dernier un panel Zoom en ligne intitulé « Comment s’en sortir sans trop de stress? ». Comme l’indique le descriptif de l’événement :
« Peur d’être contaminé, inquiétudes pour nos proches les plus vulnérables, difficultés financières, incertitudes professionnelles, tensions familiales: la COVID-19 alimente de nombreux stress. Comment les reconnaître pour mieux les déconstruire? Comment bâtir sa résilience face à cette crise sanitaire majeure? Quatre spécialistes du stress répondront à vos questions. »
Ces quatre chercheur.es étaient tous affilié.es au Centre d’études sur le stress humain (CESH), dont la fondatrice et directrice scientifique, Sonia Lupien. Cette dernière explique d’entrée de jeu l’origine évolutive du stress en utilisant la mascotte de leur centre d’étude, le bon vieux mammouth ! Qu’ont fait nos ancêtres devant lui ? Ils ont fui ou ils l’ont combattu. Les autres, ceux qui sont restés bien relaxe sans rien faire, n’ont pas laissé beaucoup de descendants… C’est donc pour cette raison, il faut toujours le répéter, que nous avons la propension à être stressés devant une menace : c’est la réponse physiologique de notre corps pour agir plus efficacement et préserver ainsi la structure de notre organisme. Autrement dit, survivre.
Mais il y a une distinction importante que fait le Dr. Lupien immédiatement, et c’est la différence entre un stress absolu et un stress relatif. J’aimerais ajouter quelques mots sur cette importante notion. Comme elle l’explique, un stress absolu, c’est comme le mammouth, ou aujourd’hui un ours qui débarquerait chez vous. Ça va stresser tout le monde, car tout le monde peut en être victime immédiatement. Un stress relatif, comme son nom le suggère, va varier selon les personnes. Parler devant une classe peut être un plaisir pour certaines personnes et un calvaire pour d’autres. Improviser ses vacances au jour le jour peut être vécu comme une grande liberté pour certain.es mais constituer un stress pour les gens qui supportent mal l’imprévisibilité.
On peut maintenant se demander, et c’est le sens de mon ajout, pourquoi certaines situations peuvent être stressantes pour certaines personnes et pas pour d’autres. Bien sûr, nous avons tous et toutes des tempéraments et des traits de personnalité différents, et l’on sait que ces différences dépendent en grande partie de notre histoire de vie. Mais j’aimerais insister sur ce point : nous sommes des êtres doublement historiques. Car d’une part il y a cette longue histoire évolutive qui a façonné nos corps et nos systèmes nerveux et qui a mis en place la mécanique complexe de notre réponse de stress face à une menace. Et d’autre part, il y a aussi ce que des gens comme Francisco Varela appellent notre « dérive ontogénique » qui n’est rien d’autre que la somme des expériences plaisantes et déplaisantes rencontrées depuis notre naissance. Et c’est cette trajectoire qui nous est unique qui a construit en nous un monde de significations bonnes ou mauvaises qui nous est propre.
Chacun a donc son monde de signification engrammé sous différentes formes dans son système nerveux, et c’est par rapport à celui-ci que les différents événements qui se présentent à nous vont être évalués comme plaisants, neutres ou stressants. Ensuite, notre vaste cortex capable des simulations les plus détaillées de situations futures fera le reste, pour le meilleur et souvent le pire. Le pire que l’on appelle couramment l’anxiété, c’est-à-dire quand, ayant associé une situation sociale à un dangereux mammouth, celui-ci s’installe à demeure dans nos pensées quotidiennes, même s’il n’est pas vraiment présent dans la réalité. Or on sait qu’une simulation d’une situation stressante ne diffère au fond très peu, au niveau de l’activation cérébrale, de la perception d’un stresseur réel. Et comme le cerveau est constamment connecté au corps, les effets d’une production soutenue d’hormones de stress si cette simulation perdure dans le temps risquent d’être aussi néfastes pour la santé dans le premier cas que dans le second. Et comme l’un de ces effets néfastes du stress chronique est une moins grande efficacité du système immunitaire, on ne veut pas ça, surtout en ces temps de COVID.
COVID qui risque donc d’avoir, si on y applique ce que l’on vient de dire, un effet de stress absolu car il menace l’intégrité physique de tout le monde, mais certainement aussi un effet de stress relatif selon le niveau d’insécurité, de connaissance des enjeux ou des précautions efficaces à prendre de chacun. Et tant qu’à être dans l’actualité, je me risquerais à un dernier exemple : un policier blanc qui interpelle un groupe de personnes noires aux États-Unis doit sans doute être pour ces personnes pas loin d’un stresseur absolu…
* * *
Un moyen de réduire le stress associé à la COVID-19 peut être de réduire son incertitude quant aux probabilités qu’on a de l’attraper dans diverses situations. Et c’est exactement ce qu’explique en un peu plus de 5 minutes cette petite vidéo plutôt bien faite. Le message à retenir, c’est l’idée de réduction des situations qui comportent des risques. Pas la sécurité absolue qui, du reste, n’existe pas en en épidémiologie (à moins de se couper de tout contact humain, auquel cas ce sont les problèmes de santé mentale qui vont assez vite prendre le relai !). Et ça s’évalue en termes de distance physique avec les autres, de durée des interactions avec eux et du lieu de ces interactions. Le grand air de l’extérieur qui fait la vie dure au virus étant bien mieux que le calme de l’intérieur de nos bâtiments où les virus restent en suspension dans l’air plus longtemps.
* * *
Dans un article récent, le rédacteur indépendant Perig Gouanvic livre enfin une exploration extrêmement bien documentée sur ce qu’on sait et surtout ce qu’on ne sait pas de la prise de certains suppléments vitaminiques sur la COVID-19. Il pose de plus les bases d’une réflexion beaucoup plus large sur le gradient « respect intégral des protocoles habituels versus l’essai rapide des molécules prometteuses pour sauver des vies ». Et puis en prime, les défenseur.es à tout crin d’une certaine médecine officielle proche des pharmaceutiques en prennent pour leur rhume (ou leur COVID?), ce qui ajoute, il faut bien le dire, au plaisir de cette lecture…
* * *
Pour ce qui est de l’ajout de dernière minute, il s’agit d’une entrevue publiée dimanche dernier dans le journal The Guardian avec Karl Friston. Friston, un important personnage des neurosciences contemporaines dont on a déjà parlé dans ce blogue, applique en ce moment ses techniques de modélisation dynamique déjà éprouvée dans différentes domaines comme l’imagerie cérébrale, à la COVID-19 avec des résultats très intéressants. Mais comme c’est souvent avec Friston, le débat n’est jamais loin, et pas toujours pour de bonnes raisons. C’est en tout cas ce que Maxwell Ramstead (dont on a aussi parlé ici) a voulu montré dans une série de tweets dirigés contre les propos de David Cox, le directeur d’IBM, qui s’était montré peu charitable à l’endroit de cette incursion de Friston dans les données épidémiologiques. Mais comme le montrent les précisions de Ramstead, et comme le disait le neurobiologiste Robin Carhart-Harris : « underestimate Karl at you peril »…
Non classé | Comments Closed