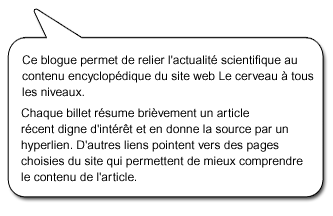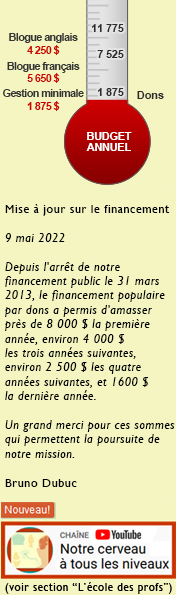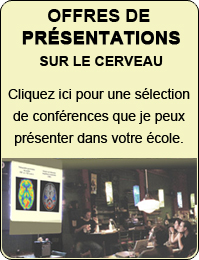lundi, 11 janvier 2021
Faire l’effort d’apprendre de ses erreurs
 C’est aujourd’hui que les enfants québécois du primaire retournent à l’école. Ils vont cependant le faire dans des classes qui, malgré le discours rassurant du ministre de l’éducation, sont souvent encore mal ventilées. Et ce, alors même qu’était publié la semaine dernière une lettre ouverte de 363 experts canadiens avec l’appui d’experts internationaux et d’autres professionnels implorant les décideurs de s’attaquer de front à la transmission de la COVID-19 par les aérosols en suspension dans l’air des espaces mal ventilés avec une forte densité de personnes, ce qui correspond malheureusement assez bien à nombre de classes de nos écoles primaires. Tout cela dans le climat anxiogène de la pandémie accentué récemment par le couvre-feu imposé par un gouvernement très prompt à faire porter le blâme sur les individus, avec la fragilisation de la santé mentale de plusieurs qui s’ensuit, que de reconnaître ses propres cafouillages (par exemple sa position pas si lointaine pour le moins assez tiède sur le port du masque, pourtant déjà reconnu à l’époque comme la mesure barrière numéro un).
C’est aujourd’hui que les enfants québécois du primaire retournent à l’école. Ils vont cependant le faire dans des classes qui, malgré le discours rassurant du ministre de l’éducation, sont souvent encore mal ventilées. Et ce, alors même qu’était publié la semaine dernière une lettre ouverte de 363 experts canadiens avec l’appui d’experts internationaux et d’autres professionnels implorant les décideurs de s’attaquer de front à la transmission de la COVID-19 par les aérosols en suspension dans l’air des espaces mal ventilés avec une forte densité de personnes, ce qui correspond malheureusement assez bien à nombre de classes de nos écoles primaires. Tout cela dans le climat anxiogène de la pandémie accentué récemment par le couvre-feu imposé par un gouvernement très prompt à faire porter le blâme sur les individus, avec la fragilisation de la santé mentale de plusieurs qui s’ensuit, que de reconnaître ses propres cafouillages (par exemple sa position pas si lointaine pour le moins assez tiède sur le port du masque, pourtant déjà reconnu à l’époque comme la mesure barrière numéro un).
Il arrive souvent que l’ignorance (ou l’incompétence) débouche sur un constat d’impuissance qui incite à blâmer les individus au lieu des causes structurelles qui les affligent. On peut penser ici bien sûr aux personnes vivants en situation de pauvreté dans un système économique conçu pour faire de l’argent avec de l’argent, et donc pour garder par définition ceux qui n’en ont pas dans la précarité. Un autre exemple m’est venu d’une amie qui enseigne le français au collégial. Elle me racontait récemment que plusieurs de ses collègues, devant les étudiant.es faibles en français, avaient tendance à jeter l’éponge et à les considérer comme des cas individuels irrécupérables. Or mon amie et d’autres professeurs pensent au contraire qu’il est possible d’aider ces étudiant.es qui font beaucoup de fautes d’orthographe et de syntaxe, notamment en s’inspirant de travaux en sciences cognitives.
Mon amie me disait montrer par exemple à ses étudiant.es la fameuse étude sur le gorille invisible dont je lui avais parlé il y a longtemps. Elle cherchait par là à les convaincre que si on ne porte pas sélectivement attention à la recherche de fautes d’orthographes par exemple en se relisant, elles peuvent être nombreuses à rester « invisibles » pour nous. Mais lors de son appel téléphonique récent, mon amie cherchait des conseils plus généraux à donner à ses étudiant.es et qui découleraient de ce que les sciences cognitives contemporaines ont à dire sur l’apprentissage. En lien avec le début de cet article, je pourrais bien sûr rappeler l’importance de l’absence de stress dans l’ambiance général de la classe. Mais si j’avais à donner un conseil vraiment de base, ce serait peut-être simplement de toujours commencer par se rappeler que notre cerveau est plastique, qu’on peut renforcer nos synapses qui forment l’engramme de nos apprentissages. C’est en tout cas ce que montrent les travaux d’une autre femme remarquable, la psychologue américaine Carol Dweck, dont j’avais déjà parlé rapidement en évoquant quelques grands principes pour mieux comprendre le cerveau humain.
Ses études du milieu des années 2000 ont montré que le seul fait d’expliquer à des jeunes de 5e année du primaire que leur cerveau peut développer de nouvelles habiletés avec la pratique et l’effort a des effets positifs sur leur apprentissage futur. Ces jeunes plus conscients de la plasticité de leur cerveau développaient une meilleure attitude après des erreurs ou des échecs. Cela devenait possible pour eux d’envisager améliorer leur français écrit, par exemple, en changeant des choses dans leur cerveau. Et ça avait aussi pour effet que leur motivation était plus forte pour maîtriser ces nouvelles compétences.
Pour Dweck, cette conception évolutive de nos capacités d’apprentissage, qui correspond à la souplesse neuronale sous-jacente, doit remplacer une conception implicite très répandue où notre intelligence est vu comme quelque chose de fixé d’avance, quelque chose qui nous est donné à la naissance et qu’on va même tenter de quantifier avec un quotient intellectuel. Et ça c’est un frein majeur pour la curiosité, la motivation et l’apprentissage. Dweck et son équipe l’ont bien démontré en suivant par exemple les performances scolaires de plusieurs centaines d’élèves dont certains avaient une conception fixiste de l’intelligence et d’autres une conception évolutive d’une intelligence qui peut changer avec la pratique (« growth mindset versus fixed mindset », pour le dire comme Dweck).
Au début du suivi, les performances en mathématiques des élèves fixistes et évolutifs étaient comparables. Mais lorsque les difficultés d’acquisition des notions sont devenues plus ardues, les évolutifs ont surpassé leurs camarades fixistes. Le fait de s’être focalisés sur l’apprentissage, l’effort et la persévérance, dans une logique de transformation graduelle, avait porté ses fruits.
On sait que des conditions adverses durant les premières années de vie peuvent amener des retards d’apprentissage, par exemple. Mais reste que l’intelligence, « whatever that means », n’est pas quelque chose qui est fixé d’avance et peu importe d’où l’on part, on peut apprendre et s’améliorer durant toute notre vie.
Mais comme société, on part de loin, justement. Parce que beaucoup de gens pensent encore notre cerveau comme le hardware d’un ordinateur. Et que nos connaissances, on les acquiert comme s’il existait des choses extérieures que nous saisirions pour les stocker dans notre tête, comme sur un disque dur. Alors que les sciences cognitives ont montré qu’un animal n’a pas le choix de modifier la structure elle-même de son cerveau en fonction des valeurs positives, négatives ou neutre qu’on attribuait inévitablement aux êtres et aux choses.
Quand les gens ignorent ces notions de base cependant et qu’on leur dit qu’à tout moment, leur cerveau est en train de se changer lui-même, ça leur paraît difficile à croire ou à comprendre. C’est pour cette raison qu’il faut toujours se remettre dans une perspective évolutive et rappeler que nos neurones sont des cellules vivantes, donc des entités autopoïétiques, c’est-à-dire un réseaux complexe toujours en train de s’autoproduire. À ce moment-là, au contraire, ça tombe sous le sens que notre système nerveux soit modifiable.
Ça nous rappelle aussi la motivation inhérente d’un organisme vivant pour connaître le monde en l’explorant activement. Et l’idée que l’histoire de vie d’un corps particulier, même jeune comme un enfant, va faire en sorte qu’il va être motivé à aller vers ce qui semble « faire du sens » pour lui. C’est ce que des gens en sciences cognitives appelle l’engagement actif d’une personne et qui doit être au cœur de l’apprentissage. Il faut que les petits comme les grands aient envie d’apprendre certaines choses, qu’ils aient une motivation intrinsèque qui les pousse à l’action. Et non parce qu’ils y sont contraints par un intervenant ou par une force extérieure. À ce compte-là, bien des programmes qui présentent la matière à apprendre comme une suite de contenus sans liens entre eux ne vont pas dans la bonne direction. Et à l’opposé, c’est cette motivation qui part des élèves qu’on essaie de retrouver dans les démarches d’éducations alternatives de type Montessori ou autres.
* * *
J’avais déjà signalé avant les Fêtes que les navigateurs ne supporteront plus les animations faites en Flash à partir du 31 décembre prochain, tel que mentionné par exemple ici ou là, Et comme c’est le cas des animations du Cerveau à tous les niveaux, j’ai entrepris de faire convertir toutes les animations du site en format vidéo afin de ne pas perdre cet aspect original du Cerveau à tous les niveaux. Je voulais juste vous signaler que bien que non encore terminée, cette opération va bon train et l’on espère la compléter dès que possible.
Au coeur de la mémoire | Comments Closed